Peut-on considérer qu’Al-Qaïda est en fin de vie et que les récents événements ne constituaient que les derniers soubresauts d’un réseau aux abois? Ou l’organisation de Ben Laden a-t-elle une fois de plus «triomphé», c’est-à-dire a réussi à s’adapter avec succès aux défis posés par la coalition d’Etats qui se battent contre elle? Quelques éléments de réponse à partir de l’analyse de deux ouvrages récents.
Le 10 janvier dernier, Bruce Hoffman, professeur à l’université Georgetown et spécialiste du terrorisme, sonnait le tocsin: la tentative d’attentat du jeune nigérian Umar Farouk Abdulmutallab contre un avion de la Northwestern le 25 décembre 2009 et l’assassinat quelques jours plus tard par un agent double (travaillant pour Al-Qaïda et la Central Intelligence Agency américaine) de plusieurs membres de la CIA démontraient qu’Al-Qaïda bénéficiait d’une nouvelle stratégie. Selon lui, l’incapacité des Etats-Unis à arrêter Abdulmutallab ne viendrait pas d’une bureaucratie trop compartimentée, mais de la difficulté des Etats-Unis à comprendre la nouvelle stratégie d’Al-Qaïda.
Hoffman profite également de cette intervention pour écorner gaiement les analystes qui considèrent qu’Al-Qaïda est sur le déclin et sur le point de disparaître.
Qu’en est-il réellement ? Peut-on considérer qu’Al-Qaïda est en fin de vie et que les récents événements ne constituaient que les derniers soubresauts d’un réseau aux abois? Ou l’organisation de Ben Laden a-t-elle une fois de plus «triomphé», c’est-à-dire a réussi à s’adapter avec succès aux défis posés par la coalition d’Etats qui se battent contre elle?
Deux excellents ouvrages – l’un en langue anglaise, l’autre en langue française – apportent des éléments de réflexion sur la question.
1. Audrey Kurth Cronin: How terrorism ends
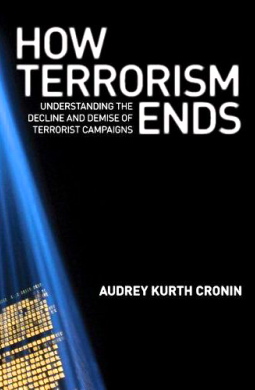 Professeur de stratégie au National War College de Washington, Audrey Kurth Cronin développe dans How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns (Princeton University Press, 2009) une partie des idées élaborées dans un article fondamental intitulé «How al-Qaida Ends, The Decline and Demise of Terrorist Groups» (cet article avait été discuté par Terrorisme.net sur le présent site).
Professeur de stratégie au National War College de Washington, Audrey Kurth Cronin développe dans How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns (Princeton University Press, 2009) une partie des idées élaborées dans un article fondamental intitulé «How al-Qaida Ends, The Decline and Demise of Terrorist Groups» (cet article avait été discuté par Terrorisme.net sur le présent site).
Les réflexions de Cronin sont fondées sur la base de données de START (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism), à partir de laquelle a été créé un index de 457 organisations terroristes (cet index reste quantitativement en deçà de l’analyse proposée par Libicki et Jones dans leur How Terrorist Groups End: Lessons for Countering Al Qa’ida, pour une recension voir www.terrorisme.net/p/article_238.shtml). On notera que l’adresse indiquée (p. 208) pour retrouver cet index n’existe pas (ou plus): www.howterrorismends.com.
Kurth Cronin voit six causes possibles à la fin de campagnes terroristes (même si elle propose une nouvelle organisation de ses critères, ils sont similaires à ceux proposés dans son article de 2006):
- la décapitation (arrestation ou élimination du leader d’un groupe terroriste)
- les négociations (transition vers un processus légitime de négociations avec le groupe)
- la réalisation des objectifs politiques du groupe
- l’échec (implosion du groupe, marginalisation de ses membres, riposte [backlash])
- la répression par la force
- la réorientation (transition vers un autre modus operandi).
Qu’est-ce qu’Al-Qaïda?
Consacrant un chapitre à chacune de ces causes qu’elle discute à l’aune de différents groupes terroristes – Sentier Lumineux péruvien, PKK kurde, Aum Shinrikyo japonais, Abu Sayyaf philippin, FARC colombien etc. – l’auteur discute dans l’ultime chapitre (pp. 167-196) de la fin d’Al-Qaïda.
Ses réflexions débutent, à juste titre, par une analyse du terme «Al-Qaïda», qui renvoie à trois réalités différentes, mais convergentes: «Al-Qaïda central» autour de Ben Laden et Ayman al-Zawahiri, une nébuleuse de groupes alignés (ou non) qui parfois répondent aux ordres d’Al-Qaïda central (Kurth Cronin l’appelle le «réseau») et des factions locales (ou des individus) sans aucun contact avec le noyau central mais qui, influencés par l’idéologie du noyau, revendiquent leurs actions sous le label «AQ» (p. 170). Souvent les analyses proposées omettent une de ces trois dimensions, en se focalisant uniquement sur l’une des références et oubliant la multiplicité de ses réalités.
Contrairement à Bruce Hoffman qui a toujours insisté sur l’importance d’AQ central, Kurth Cronin note que l’équilibre s’est déplacé ces dernières années du noyau dur – affaibli par les opérations militaires mais qui a pu, en partie, se reconstituer depuis 2007 – vers le «réseau» et les factions et différents individus qui revendiquent leurs actions sous le label sans être sous le contrôle du premier cercle (pp. 170-171).
Dans la lignée des réflexions offertes par Marc Sageman dans son Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-first Century (voir www.terrorisme.net/p/article_236.shtml), Kurth Cronin affirme qu’AQ s’apparente actuellement plus à un mouvement social qu’à un groupe terroriste classique (pp. 171-174). Ainsi, outre son caractère protéiforme, ce mouvement se distingue par ses méthodes de recrutement (qui n’est pas opéré par le haut et centralisé mais par le bas, c’est-à-dire par des liens personnels) de communication (Al-Qaïda a su exploiter Internet et les moyens de communication les plus modernes; comme le dit Kurth Cronin «Al-Qaïda est une créature du web», (p. 176) – et ses moyens de soutien – en particulier financiers – que Kurth Cronin qualifie de «robustes». Elle observe ainsi qu’à une époque, Osama Ben Laden aurait contrôlé plus de 80 entreprises à travers le monde dont certaines continuent à dégager du profit pour le mouvement (p. 174) et qui le financeraient, en partie.
On peut ici douter du bien-fondé de cet élément d’analyse: en effet, si l’on accepte l’isolation de Ben Laden (probablement caché entre l’Afghanistan et le Pakistan), son incapacité à contrôler un soi-disant «empire financier» (évoqué à maintes reprises) et le fait que les attaques de ces dernières années aient justement été caractérisées par une économie de moyens (ainsi les attentats de Madrid aurait coûté moins de 10’000 dollars), l’innovation du mouvement réside probablement plus dans son caractère «auto-financé» que dans des moyens de soutien… «robustes».
Les innovations susmentionnées – notamment en termes de recrutement – ne sont pas sans conséquence sur la notion d’appartenance (membership) à AQ. Ainsi, Kurth Cronin est l’une des premières à noter que «dans un sens, les membres du mouvement n’ont plus du tout besoin de ‘s’affilier à’ une organisation, dans la mesure où les individus participent en appuyant sur quelques touches. Le débat sur la taille, la structure et l’appartenance à Al-Qaïda est une relique démodée du XXème siècle, transposée (displaced) par suite des effets de la technologie du XXIème siècle». (p. 176).
La fin d’Al-Qaïda
Pour terminer, Kurth Cronin s’interroge sur la fin d’Al-Qaïda et des mesures possibles à adopter. Du fait de la nature composite d’Al-Qaïda, l’auteure pense qu’une «décapitation» (c’est-à-dire la mort ou l’arrestation des membres d’Al-Qaïda central) ne constituerait pas une solution (p. 177-179). En effet, cette méthode ne résoudrait pas le problème du «réseau», ni des membres qui se revendiquent d’AQ sans aucun contact avec Ben Laden. De plus, comme elle montre dans son analyse des groupes PKK kurde (pp. 20-22) ou du Sentier Lumineux péruvien (pp. 18-20), la décapitation n’est généralement suivie d’effets que dans le cas d’organisations fortement structurées – ce qui n’est pas le cas d’un mouvement (social) comme AQ.
Dans le cadre d’éventuelles négociations, l’auteur distingue entre les différentes composantes du «tryptiqueAl-Qaïda»: alors que des discussions semblent impossibles avec le noyau dur dont les buts ne sont pas clairs et en constante évolution, des négociations sont envisageables avec certains éléments du réseau qui «poursuivent depuis longtemps des buts locaux, nationalistes» (p. 182). Cependant cette possibilité exige une approche nuancée qui ne soit pas motivée par une analyse monolithique d’Al-Qaïda (p. 181), mais prenne en considération les différentes réalités qui se cachent derrière ce terme.
Outre la négociation, Kurth Cronin s’intéresse également à d’autres facteurs qui peuvent conduire à la fin d’Al-Qaïda et notamment l’implosion du mouvement. Cette dernière peut être le résultat d’une a) fractionalisation b) d’une perte du contrôle opérationnel c) d’une perte du soutien populaire. L’intérêt de la discussion autour de ces trois facteurs réside dans les révélations qu’ils apportent sur Al-Qaïda.
Kurth Cronin reconnaît la fragmentation régnant dans les rangs des différents éléments qui constituent Al-Qaïda. Elle rapporte par exemple les propos de Ben Laden qui parlait déjà de la fitna – ou discorde – qui régnait parmi les combattants en Afghanistan (pp. 183-184). Selon l’auteur, les disputes internes autour de l’apostasie, du droit de tuer d’autres musulmans, des attaques de l’économie de pays musulmans pourraient constituer des talons d’Achille (pp. 184) qui, bien exploités, pourraient faire tomber le mouvement.
Une autre faiblesse du mouvement réside dans son incapacité à contrôler tous les éléments qui se revendiquent d’Al-Qaïda et dont les actions peuvent s’avérer contre-productives, comme ce fut le cas en Irak dès 2005 où les sunnites irakiens se retournèrent contre la branche irakienne du mouvement (p. 185). Cette incapacité à contrôler les éléments se revendiquant d’Al-Qaïda peut également être exploitée pour aliéner les populations, notamment à la suite du meurtre de civils musulmans.
Une analyse intéressante
L’ouvrage d’Audrey Kurth Cronin est sans conteste l’un des meilleurs – et des rares – sur la fin des groupes terroristes. Son analyse nuancée du «tryptique Al-Qaïda» et des stratégies à adopter en fonction de l’élément considéré en font l’une des contributions les plus intéressantes sur le sujet.
On regrettera cependant que l’analyse sur le «réseau» et les individus n’ait pas bénéficié d’un développement plus approfondi, comme par exemple de la relation entre Al-Qaïda et les Talibans ou l’évolution du réseau en Afrique du Nord et subsaharienne (Al-Qaïda au Maghreb islamique).
De plus, certaines réflexions – notamment sur le financement du mouvement – doivent être considérées avec précaution.
2. Jean-Pierre Filiu: Les neufs vies d’Al-Qaïda
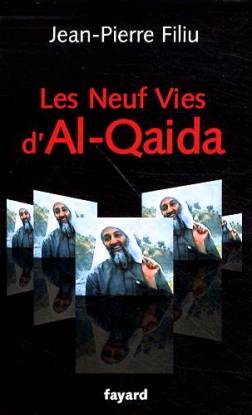 Alors que Kurth Cronin se penche sur les groupes terroristes en général et applique ses réflexions à Al-Qaïda en particulier, Jean-Pierre Filiu consacre l’ensemble de son ouvrage à l’organisation / réseau /mouvement d’Osama ben Laden.
Alors que Kurth Cronin se penche sur les groupes terroristes en général et applique ses réflexions à Al-Qaïda en particulier, Jean-Pierre Filiu consacre l’ensemble de son ouvrage à l’organisation / réseau /mouvement d’Osama ben Laden.
Revendiquant l’héritage des analyses développées au sein de la Chaire Moyen-Orient de Sciences Po, Paris (dont il est professeur associé) et de la tradition du journalisme d’investigation à l’anglo-saxonne (incarnée par Jason Burke, Lawrence Wright ou Peter Bergen), Les neuf vies d’Al-Qaïda offre l’un des aperçus les plus complets et exhaustifs sur le mouvement en langue française.
Débutant sur le récit des «neufs vies» opérées par Al-Qaïda en l’espace de vingt ans, l’analyse de Filiu se termine par une synthèse des forces et faiblesses et trois scénarios sur le futur possible du mouvement. Utilisant le cadre conceptuel des «vies» qu’il qualifie de «métamorphoses», Filiu éclaire le caractère résolument dynamique d’Al-Qaïda et ses multiples transformations en deux décennies.
Comme Kurth Cronin, Filiu évite l’écueil des analyses statiques qui ignorent le caractère multiforme et pluri-référentiel du terme. Comme il l’écrit, «Les spécialistes ont même pu diverger dans leur vision fondamentale de l’organisation, depuis le tableau d’un appareil centralisé et étanche jusqu’à l’affirmation provocatrice: «Al-Qaïda n’existe pas». Le paradoxe est que ces deux visions extrêmes comportent toutes deux une part de vérité, car elles correspondent aux deux interprétations du terme «Al-Qaida», qui signifie en arabe «la base»: la «base solide» et territoriale, où une hiérarchie à l’étonnante longévité (…) édicte les orientations valables pour l’ensemble des membres; et la «base de données», le réseau transfrontalier des partisans et des sympathisants du jihad global, à vocation planétaire (p. 241)».
Simplicité du message, virtualité et plasticité de l’organisation
L’intérêt d’une comparaison entre l’ouvrage de Kurth Cronin et Filiu réside dans la similarité de leurs analyses. Ainsi, alors que la professeure de stratégie voit dans le recrutement, les moyens de communication et les moyens de soutien les innovations d’Al-Qaïda, Filiu complète ce tableau en insistant sur la simplicité du message proposé. Il reconnaît également l’usage révolutionnaire des moyens de communication opéré par Al-Qaïda (il parle de «virtualité» du mouvement, p. 244-249) et la plasticité de l’organisation.
Dans son analyse, les trois caractéristiques évoquées ci-dessus (plasticité, virtualité de l’organisation et simplicité du message) se transforment en faiblesses possibles du mouvement.
Ainsi, malgré sa simplicité et son caractère percutant, le message religieux d’Al-Qaïda se limite à quelques hadiths sorties de leur contexte et dont l’importance dans l’exégèse coranique laisse à désirer (p. 253). A cet égard, la faiblesse du message religieux n’a pas échappé aux autorités saoudiennes (ou plus récemment mauritaniennes) qui ont créé des dialogues entre leurs «djihadistes» et les plus hautes autorités religieuses du pays visant à démontrer la déviance que représente le message de Ben Laden et ses sbires.
La contestation de la pertinence du message religieux est également renforcée par les critiques adressées ces dernières années par d’anciens oulémas considérés comme favorables à Al-Qaïda, tel le Dr. Fadel ou le cheick Auda – autorité religieuse qui avait favorablement influencé Ben Laden dans les années 1990 (p. 254).
De plus, malgré son caractère transnational, Filiu s’interroge également sur la capacité du mouvement à survivre aux logiques nationales défendues par les différents mouvements auprès desquels Al-Qaïda central a trouvé refuge (à l’heure actuelle auprès des Talibans dans la zone afghano-pakistanaise, p. 259).
Filant la comparaison autour «d’Al-Qaïda» comme base territoriale et virtuelle (dans son acception de «base de données»), l’auteur note la disparition progressive d’Al-Qaïda du monde réel – notamment du fait d’une aliénation des populations ou de purges internes – et son retranchement dans un monde virtuel où sa présence est également contestée (contestation de son message religieux, piratage de ses sites et forums etc., p. 262-264).
Filiu termine son analyse sur trois scénarios possibles pour le mouvement: dissolution, éclatement ou nouveau regain de violence suite à une agression internationale. C’est seulement dans ce dernier cas qu’il est possible d’imaginer une survie au mouvement sous sa forme actuelle, relancé (par exemple) par une attaque américaine contre l’Iran (p. 275-276). Dans le cas de l’éclatement, on assisterait à une fragmentation – semblable à celle des mouvements terroristes de gauche en Europe dans les années 1970 – qui sonnerait le glas des bribes de contrôle opérationnel dont dispose encore Al-Qaïda central. Dans le cas de la dissolution, Al-Qaïda sombrerait petit à petit dans l’oubli…
Conclusion
Extrêmement détaillée, maniant avec maestria les protagonistes influents et les dates, offrant une réflexion à long terme basées sur des prémisses claires et précises, l’analyse de Filiu présente reste cependant ambiguë quant à Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Filiu évoque en effet le «sérieux potentiel d’internationalisation de la terreur» (p. 215) de cette organisation tout en qualifiant ses actions de «délinquance jihadiste dans le désert saharien» qui n’aurait «changé ni de nature, ni de logique avec le ralliement du GSPC à Al-Qaïda» (p. 216).
Arrêtant son analyse en août 2009, Filiu omet dans sa chronologie l’assassinat d’un ressortissant américain en juin 2009 (en Mauritanie), qui pourrait représenter un changement qualitatif vis-à-vis de la «délinquance du désert saharien» évoquée précédemment.
Ainsi, les récents événements dans la zone sahélienne entre la Mauritanie, le Mali et le Niger – enlèvement d’un ressortissant français, de trois Espagnols et d’un couple italien entre le 26 novembre et le 17 décembre 2009 – pourraient inaugurer une nouvelle ère de violence terroriste, malheureusement éloignée de la «petite criminalité» évoquée par Filiu.
