Avec les événements qui ont marqué les quatorze derniers mois, le Pakistan et l’Afghanistan se sont retrouvés au coeur de l’actualité. Nombre de reportages ont évoqué des écoles coraniques et des groupes dont les noms ne disent pas grand chose à la plupart des Occidentaux. Deux universitaires français qui connaissent bien la région nous livrent un petit volume qui nous permet de mieux nous retrouver dans ce dédale et ces réseaux.
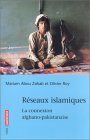 Il convient d’abord de souligner la concision de cet ouvrage: quelque 80 pages, certes denses, mais toujours lisibles. Ceux qui se sentent découragés par d’épaisses thèses peuvent donc aborder sans crainte ce petit “précis” sur les réseaux islamiques afghano-pakistanais.
Il convient d’abord de souligner la concision de cet ouvrage: quelque 80 pages, certes denses, mais toujours lisibles. Ceux qui se sentent découragés par d’épaisses thèses peuvent donc aborder sans crainte ce petit “précis” sur les réseaux islamiques afghano-pakistanais.
L’islamisme, soulignent Mariam Abou Zahab et Olivier Roy dans leur introduction, peut fort bien déboucher sur un islamo-nationalisme. Mais, dans d’autres cas – et ce sont ceux auxquels ils s’intéressent avant tout dans leur étude – “ils mettent la oumma des musulmans au-dessus des identités et des intérêts ethniques ou nationaux” (p. 6). L'”oummisme” lui-même n’est pas nécessairement radical: il le devient lorsqu’il lance l’appel au djihad armé.
Ce qui ressort aussi de ce petit volume est la nature changeante de ce paysage. Nous avons trop souvent tendance à voir les mouvements islamistes, radicaux ou non, sous des formes figées, alors qu’ils sont marqués par des débats et des évolutions. Ce fut le cas des taliban afghans, qui n’étaient pas antioccidentaux au début, mais “se sont radicalisés dans un sens néofondamentaliste sous l’influence de Ben Laden” (p. 20).
En ce qui concerne le Pakistan, le tour d’horizon est particulièrement bienvenu, car il n’est pas toujours simple de se retrouver dans le “foisonnement de mouvements et de sigles” observé depuis la fin des années 1980, sur fond de fractures tant ethniques que religieuses (15 à 20% de chiites, subdivisions des sunnites en plusieurs écoles) (p. 27). Les mouvements religieux traditionnels du Pakistan n’ont “aucune tradition de radicalisme politique” (même s’ils ont pu adopter des positions très militantes sur des questions précises), mais ils connaissent des phénomènes de passage au politique – accompagné d’un radicalisme croissant – dans les années 1980, précisément (p. 29). Les services de renseignement militaires pakiatanais (ISI) n’y ont pas été étrangers, leur perspective étant celle de l’utilisation de ces groupes pour le djihad en Afghanistan et au Cachemire.
Le livre offre un intéressant panorama sur les mouvements opposés aux chiites ainsi que sur les groupes actifs au Cachemire – ce point ultra-sensible du sous-continent indien – , par exemple le Lashkar-e Taiba, “branche armée du Dawat wal Irshad […], devenue le mouvement le plus actif au Cachemire indien, où elle a supplanté tant le Jammu and Kashmir Liberation Front (nationaliste) que le Hizb ul-Mujahidin lié au Jamaat e-Islami” (p. 39). Comme on le sait, ce groupe s’est livré à plusieurs opérations non seulement au Cachemire, mais également dans de grandes villes indiennes. L’on note avec intérêt que, contrairement aux groupes militants nationalistes traditionnels du Cachemire, son objectif n’est pas que la libération de cette région, mais d’en faire un premier pas pour un djihad beaucoup plus vaste – qu’il entend étendre tout d’abord à l’Inde entière, au nom de ses 200 millions de musulmans. Il est présent également de constater que, jusqu’à sa dissolution au début de l’année 2002, le Lashkar-e Taiba disposait d’un réseau serré de bureaux locaux à travers tout le Pakistan – pas de moins de 2.000 bureaux, selon les chiffres donnés par les auteurs, qui ne sont pas suspects d’assertions sensationnelles (p. 40). Même à l’échelle de pays peuplés, cela fait prendre la mesure de phénomènes que l’on ne peut considérer comme simplement marginaux: c’est tout le problème de ce type de groupes radicaux qui bénéficient de certaines sympathies dans des sections plus larges de la population – même si elle ne les soutiendra pas sur tous les points, mais la question du Cachemire est bien sûr un argument idéal.
Relevons également plusieurs pages très informatives sur la pratique du martyre dans le groupe (pp. 41-46). A noter que le Lashkar-e Taiba ne se lance pas dans des opérations suicides au sens strict – car il reste attaché à la prohibition traditionnelle du suicide dans l’islam – mais en revanche se livre à des opérations très risquées et dont les auteurs ont peu de chance de revenir vivants, choix qu’ils acceptent et auquel ils aspirent, mais tout en souhaitant exterminer tout d’abord le plus d’ennemis possible. Ils retournent au combat jusqu’à ce qu’ils parviennent au martyre (p. 44).
Dans quel sens comprendre les réseaux afghano-pakistanais? Les explications fournies par Olivier Roy et Mariam Abou Zahab permettent de les comprendre un peu mieux:
“Les liens transnationaux entre la nébuleuse religieuse pakistanaise, les taliban et al-Qaida ne semblent pas avoir de base organisationnelle. En fait, tout repose sur les connexions personnelles, les filières de madrasas, les rencontres dans les camps d’entraînement et les conjonctions d’intérêts.” (p. 59)
Les auteurs soulignent aussi la double logique de fonctionnement des réseaux internationalistes: locale et globale. “La ressemblance des discours (l’appel au djihad et à la oumma) ne doit pas occulter les logiques locales, essentiellement ethniques.” (p. 63)
Ce petit volume sans équivalent en français trouvera donc sa place dans les bibliothèques de tous ceux qu’intéressent les courants islamistes.
Mariam Abou Zahab et Olivier Roy, Réseaux islamiques: la connexion afghano-pakistanaise, Paris, Autrement (coll. CERI), 2002, 88 p.
|
Pour commander ce livre chez Amazon.fr: |
