Dans une récente contribution, Terrorisme.net s’était intéressé à une forme de discours émergent sur le déclin d’Al-Qa’ida. Défendue par des auteurs comme Marc Sageman, Lawrence Wright ou les auteurs du Human Security Brief, ce discours considère qu’Al-Qa’ida est sur le déclin. Au-delà de la question spécifique du déclin du réseau d’Osama ben Laden, on peut s’interroger sur la fin des organisations (groupes / réseaux) terroristes en général. A l’exception d’un remarquable article d’Audrey Kurth Cronin dédié à Al-Qa’ida (“How al-Qaida Ends: The Decline and Demise of Terrorist Groups“, 2006) et d’une étude de Max Abrams (“Why Terrorism Does Not Work”, 2006), cette thématique a jusqu’ici été largement ignorée par la communauté scientifique. Dans cette perspective, on lira avec intérêt – assorti d’une certaine prudence – un récent ouvrage de Seth Jones et Martin Libicki intitulé How Terrorist Groups End: Lessons for Countering al Qa’ida.
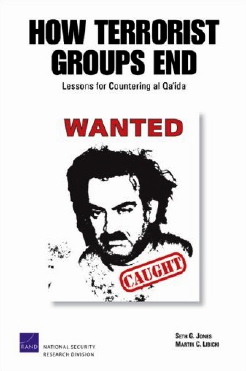 1. Un large échantillon
1. Un large échantillon
Si l’on considère les groupes analysés, l’étude de Libicki et Jones compte certainement parmi les plus complètes à ce jour. En effet, celle-ci prend en considération pas moins de 648 groupes et organisations terroristes actifs de 1968 à 2006. Ce remarquable échantillon est basé notamment (mais pas exclusivement) sur la base de données du Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT – MIPT Terrorism Knowledge Base: A Comprehensive Databank of Global Terrorist Incidents and Organizations) [comme indiqué dans un article précédent, le MIPT, son site et sa base de données ont été fermés en 2014 faute de ressources financières – 21.06.2016].
Contrairement à Audrey Kurth Cronin qui détermine 7 raisons possibles à la fin d’organisations terroristes, cette étude considère 5 raisons principales, la première étant – dans 43 % des cas – l’adoption de tactiques non-violentes et la participation à un processus politique. La fragmentation des groupes («splintering») est également considérée comme un élément important.
L’arrestation par les forces de police traditionnelles et/ ou la mort de membres-clé des groupes constituent la deuxième raison principale à la fin de groupes terroristes (dans 40 % des cas).
Comme le déclarent les auteurs «la force militaire a rarement été l’une des raisons primaires à la fin de groupes terroristes» (p. 19). Celle-ci n’a permis de mettre fin à un groupe terroriste que dans 7 % des cas. En termes politiques, cette dernière observation équivaut à une critique radicale de la stratégie militaire adoptée par le gouvernement américain depuis les attentats du 11 septembre 2001. Un chapitre entier est dédié aux conséquences de cette observation.
Dans celui-ci, Libicki et Jones critiquent l’utilisation du terme de «guerre contre le terrorisme» argumentant que l’utilisation de ce terme nécessite un transfert aux forces armées des moyens généralement attribués à des instruments efficaces (telle la police). En conclusion, les auteurs recommandent la «re-découverte» (si l’on peut dire) de tactiques contre-terroristes «classiques» comme le renforcement des services de police et l’utilisation accrue du renseignement (p. 127).
La dernière explication deà la fin de groupes terroristes réside dans leur victoire (dans 10 % des cas). A cet égard, Jones et Libicki citent le groupe de Nelson Mandela, l’ANC qui a eu recours à des tactiques terroristes, mais également le FLN algérien et l’Irgun israélien, qui ont atteint leurs objectifs (p. 33).
2. Des critères peu flexibles et stéréotypés
Au niveau de la classification des groupes, l’étude distingue entre quatre groupes principaux: extrême gauche, extrême droite, nationaliste ou religieux. Parmi les groupes d’extrême-gauche, l’étude inclut les groupes radicaux «de protection de l’environnement» ou de libération des animaux. Cette classification est surprenante et stéréotypée. En effet, la cause de la libération animale n’est pas uniquement l’apanage de groupes d’extrême gauche. On a ainsi observé ces dernières années que certains groupes d’extrême-droite avaient tenté de s’approprier la cause de la libération animale, notamment en Allemagne (1). Qui plus est, de nombreux activistes sans affiliation politique participent spontanément ou de manière systématique à des actions de libération, de sabotage ou de vandalisme. On peut également émettre de sérieux doutes quant à la classification de l’Animal Liberation Front comme groupe terroriste (p. 146).
Egalement problématique dans cette classification est l’utilisation de quatre catégories principales qui ne semblent pas laisser une très grande flexibilité aux groupes entrant dans différentes catégories. Ainsi, même si le Hamas est explicitement classifié comme «nationaliste» et pas «religieux» (voir p. 5), on peut se demander si le statut du Hezbollah ou des Talibans comme groupe religieux (p. 160 et 181) est le fruit d’une classification adéquate.
Cette dernière a des conséquences importantes dans la mesure où les groupes religieux survivent généralement plus longtemps que d’autres groupes (ainsi selon cette étude, 62 % des groupes terroristes ont pris fin, contre seulement 32 % des groupes religieux, p. 36).
3. Le retour d’Al-Qa’ida
Dans un article récent, Terrorisme.net a présenté l’émergence d’un discours «décliniste» sur Al-Qa’ida. Différents auteurs – dont notamment les auteurs du Human Security Brief 2007 (HSB) – ont soutenu qu’Al-Qa’ida était sur le déclin.
L’argument principal des auteurs du HSB est centré autour d’une analyse quantitative des victimes du terrorisme. En effet, il s’agit pour eux de démontrer l’inconsistance du décompte des victimes du terrorisme global dans les bases de données du MIPT, du National Counterterrorism Center (NCTC) et du National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START).
En effet, ces bases de données considèrent les victimes du conflit en Irak comme des victimes du terrorisme et non pas des victimes d’une guerre civile alors que les victimes d’autres guerres civiles (par exemple en République Démocratique du Congo) ne sont pas comptabilisées. En soustrayant les victimes du conflit irakien de ces bases de données, la thèse selon laquelle le nombre de victimes du terrorisme en général serait en augmentation n’est plus défendable. Concernant Al-Qa’ida, les auteurs du HSB notent le déclin du réseau d’Al-Qa’ida du fait de la perte de soutien de la population irakienne (p. 15 et 17).
Conscients des difficultés liées au conflit irakien, Libicki et Jones renoncent à inclure les actions perpétrées par Al-Qa’ida en Irak dans leur base de données (pp. 110-111). Les actions perpétrées en Afghanistan ne sont également pas incluses (pp. 110-111). Les auteurs renoncent ainsi à inclure les foyers d’actions d’Al-Qa’ida les plus contestés mais peuvent ainsi prétendre à une base de données beaucoup plus consensuelle et significative. Contrairement aux auteurs du HSB qui argumentent que la perte du soutien populaire en Irak annonce le déclin d’Al-Qa’ida, Libicki et Jones maintiennent une vision plus globale des activités du réseau d’Ousama ben Laden. On peut en effet reprocher aux auteurs du HSB d’avoir une vision trop focalisée sur l’Irak, ce qui les empêche de considérer Al-Qa’ida dans une perspective plus large.
Libicki et Jones arrivent à la conclusion que, à l’exception de 2006, le nombre d’attentats perpétrés par Al-Q’aida est augmentation pour la période 2002-2007, passant de 3 en 2002, à plus de 25 en 2007 (p. 111). Cette augmentation est notamment liée à l’émergence et à la multiplication des attentats commis en Algérie par Al-Qa’ida au Maghreb islamique (pour une liste, voir pp. 187-196), mais également du fait de la capacité d’adaptation d’Al-Qa’ida et de ses structures.
Ainsi, Libicki et Jones argumentent que la stratégie américaine de lutte et de défaite d’Al-Q’aida a échoué (p. 110) et que celle-ci doit être recentrée autour de stratégies qui fonctionnent, telle l’engagement de forces de police et le désengagement de forces militaires.
4. Conclusion
Du fait de l’importance de son échantillon (qui inclut plus de 600 groupes terroristes), l’ouvrage de Seth Jones et Martin Libicki représente incontestablement une référence quant à l’étude scientifique de la fin des groupes terroristes. On peut également saluer le fait que, dans ses conclusions, celle-ci propose de mettre un terme à l’actuelle stratégie de l’administration américaine pour en revenir à des méthodes plus traditionnelles, mais qui ont fait leur preuve. De plus, dans son appréciation d’Al-Qa’ida, celle-ci adopte une vision plus globale que les auteurs du Human Security Brief, probablement trop focalisés sur l’Irak.
Cependant, les critères de classification utilisés par Jones et Libicki doivent être considérés avec une certaine prudence. En effet, ceux-ci sont parfois stéréotypés et ne reflètent pas nécessairement la complexité d’un phénomène (comme celui de l’organisation libanaise Hezbollah ou du Front de libération des animaux).
Jean-Marc Flükiger
Note
(1) Voir par exemple Jean-Marc Flükiger, “An Appraisal of the Radical Animal Liberation Movement in Switzerland: 2003 to March 2007”, Studies in Conflict & Terrorism, 31, 2008, p. 154.
