Les événements survenus en Norvège en juillet 2011 – qui ont coûté la vie à 77 personnes – ont attiré et focalisé l’attention publique sur le terrorisme perpétré par des individus que l’on peut qualifier de «terrorisme du loup solitaire». Six mois après ces événements tragiques, Ramon Spaaij, chercheur en sciences sociales à l’université La Trobe de Melbourne, propose une analyse systématique du phénomène.
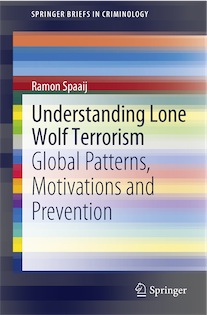 Intitulé Understanding Lone Wolf Terrorism: Global Patterns, Motivations and Prevention, son ouvrage offre quelques informations précieuses sur le phénomène, tout en soulevant un certain nombre de questions.
Intitulé Understanding Lone Wolf Terrorism: Global Patterns, Motivations and Prevention, son ouvrage offre quelques informations précieuses sur le phénomène, tout en soulevant un certain nombre de questions.
1. Données
L’auteur se base sur un échantillon de 88 «terroristes du type loup solitaire» (lone-wolf terrorists) ou plus simplement des «loups solitaires» qui ont agi entre 1968 et 2010.
Débutant par l’assassinat de Robert Kennedy par Sirhan Sirhan en 1968, son échantillon inclut notamment les attentats d’Eric Rudolph (responsable des attaques contre les Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996), de Malik Nidal Hassan («le loup de Fort Hood»), ou encore Umar Farouk Abdulmuttalab (qui a tenté de faire sauter un avion au-dessus de Detroit le jour de Noël 2009). Même si les événements en Norvège ont eu lieu en 2011, l’auteur offre également quelques réflexions sur Anders Behring Breivik.
L’échantillon regroupe les données collectées dans 15 pays (Grande-Bretagne, Allemagne, France, Espagne, Italie, Pologne, Pays-Bas, Danemark, Suède, République tchèque, Portugal, Russie, Australie, Canada et les Etats-Unis) et sont tirées essentiellement de la Global Terrorism Database – une base de données qui regroupe les incidents terroristes depuis 1968 – et de la RAND-MIPT Terrorism Knowledge Database, une autre base de données qui a cessé ses activités en 2008 (mais à laquelle a succédé la RAND Database of Worldwide Terrorism Incidents).
Spaaij constate, à juste titre, les problèmes posés par un certain nombre d’entrées dans la Global Terrorism Database (pp. 10-12) qu’il discute.
Il propose également une étude spécifique de cinq cas paradigmatiques qu’il propose d’utiliser pour mieux comprendre le phénomène. Il s’agit de Ted Kaczynski («Unabomber»), de Franz Fuchs (responsable d’une campagne terroriste dans les années 1990 en Autriche), de l’assassin du Premier Ministre israélien Yithzak Rabin (Yigal Amir), de David Copeland appelé «le poseur de bombes à clous» (responsable d’une campagne terroriste à Londres en 1999), et de l’assassin du politicien néerlandais Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf.
2. Définitions
Pour l’auteur, les loups solitaires sont caractérisés par le fait qu’ils a) agissent individuellement, b) n’appartiennent à aucun réseau ou groupe terroriste organisé, et c) leurs modi operandi sont conçus et dirigés par l’individu, sans aucun ordre ou hiérarchie extérieurs (p. 16). Ils agissent en suivant des «convictions politiques, idéologiques ou religieuses fortes, planifient leurs actions avec soin et peuvent cacher avec succès leurs opérations des personnes qu’ils côtoient» (p. 17). Spaaij distingue ici entre les loups solitaires et les «fous solitaires» dont l’objectif est «intrinsèquement idiosyncrasique, complètement égocentrique et profondément personnel» (p. 20).
Même s’ils sont utiles, les éléments de définition proposés par l’auteur ne permettent pas d’inclure dans la base de données l’un des exemples les plus paradigmatiques de «terrorisme du loup solitaire»: les attentats de Timothy McVeigh à Oklahoma City en 1995 qui coûtèrent la vie à 168 personnes. Selon Spaaij, même si l’attaque a été perpétrée par un individu, son complice Terry Nichols a «joué un rôle considérable dans la préparation des attaques» (p. 18). Ainsi, «on peut argumenter que le soutien de Nichols a aidé McVeigh a passer de la théorie à l’action, par exemple en sélectionnant la cible (…), en achetant les composantes de la bombe, etc.» (p. 29). De plus, il y aurait des preuves selon lesquelles McVeigh aurait été affilié à des groupes chrétiens fondamentalistes (p. 18).
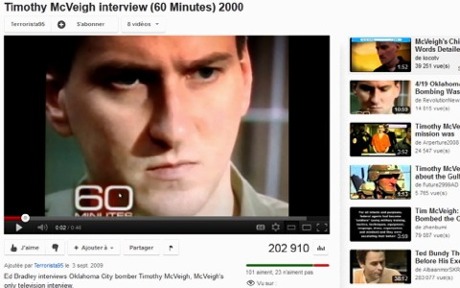
Timothy McVeigh: interview dans l’émission 60 Minutes en l’an 2000.
A première vue, il semble contre-intuitif qu’une étude sur les loups solitaires ne puisse prendre en considération ce qui semble être l’exemple par excellence d’un tel mode d’action.
On peut également se demander pourquoi avoir inclus Umar Farouk Abdulmuttalab, auteur d’une tentative d’attaque le jour de Noël 2009, et pas McVeigh. En effet, il semblerait qu’Abdulmuttalab ait eu des contacts directs, au Yémen, avec Al-Qa’ida dans la péninsule arabique (AQPA), qui l’aurait aidé dans ses préparatifs. Les critères b) et c) ne semblent ici pas respectés.
Un autre exemple surprenant pris en considération par Spaaij est celui de de John Allen Muhammad (voir p. 112) qui terrorisa, avec son compagnon John Lee Malvo, la capitale américaine pendant plusieurs semaines en 2001, faisant 10 victimes. Même s’il est avéré que J.A Muhammad travaillait en tandem (son complice a écopé d’une peine de prison à perpétuité), celui-ci est considéré par Spaaij comme un exemple de loup solitaire, contrairement à Timothy McVeigh.
Pour terminer, une application cohérente des critères du terrorisme du loup solitaire devrait également exclure Yigal Amir des réflexions de Spaaij qui le considère comme un cas paradigmatique.
En effet, selon plusieurs sources concordantes récentes et plus anciennes, Yigal Amir avait discuté à plusieurs reprises de l’assassinat du Premier Ministre avec son frère. Selon une étude publiée en 1999 par Ehud Sprinzak (recensée par Terrorisme.net), ce serait même son frère qui aurait préparé les balles utilisées par Yigal Amir pour tuer Yitzhak Rabin (voir p. 279). L’étude en question est citée par Spaaij.

Yigal Amir dans un reportage diffusé sur la chaîne France24.
Plus récemment, les chercheurs Ami Pedahzur et Arie Perlinger ont également mentionné la collaboration entre Yigal Amir et son frère dans une étude publiée en 2009.
En considérant le fait que le frère d’Amir ait également été condamné à 16 ans de réclusion pour sa participation dans les préparatifs de l’assassinat, pourquoi considérer que l’aide de Terry Nichols disqualifie McVeigh comme loup solitaire, alors qu’Yigal Amir, aidé par son frère, est considéré comme un cas paradigmatique du phénomène?
Et qu’en est-il de John Allen Muhammad? Une application cohérente des critères évoqués plus haut ne devrait-elle pas mener à l’exclusion des trois cas (ou à leur inclusion)?
3. Eléments de l’analyse de Spaaij
Spaaij offre une excellente présentation historique du développement du concept de «terrorisme du loup solitaire». Celle-ci trouve ses origines dans le mouvement anarchiste de la fin du 19ème siècle et sera ensuite développée dans les rangs de l’extrême-droite américaine, notamment par Louis Beam et son concept de «résistance sans leader».
Les deux suprématistes Tom Metzger et Alex Curtis développeront ensuite le concept en se penchant spécifiquement sur les loups solitaires. Au niveau du salafisme-jihadisme, Spaaij note à juste titre l’influence d’Abu Musab Al-Suri et de son Appel à la résistance islamique globale, dont des extraits ont notamment été publiés dans le magazine Inspire (pp. 23-26).
Les 88 terroristes loup solitaires identifiés dans l’échantillon ont perpétré un total de 198 attaques. Selon Spaaij, ceci correspond à seulement 1,8 % des incidents terroristes recensés entre 1968 et 2010 dans les 15 pays en question. D’un point de vue statistique, «le terrorisme du loup solitaire constitue un phénomène relativement marginal» (p. 27).
En termes de victimes, l’échantillon recense la mort de 123 personnes. Spaaij observe que le terrorisme du loup solitaire «fait en moyenne 0.62 victime par incident. Ce taux est relativement bas comparé à celui de l’ensemble des attaques terroristes dans les 15 pays étudiés qui est d’approximativement 1.6 morts par attaque» (p. 28). L’auteur explique ce taux plus bas par l’absence de «grandeur opérationnelle» (operational size) et de capacités.
Pourtant, l’échantillon considéré ne semble pas permettre de tirer des conclusions quant à la létalité des attaques commises par le terrorisme du loup solitaire. En effet, si on venait maintenant à ajouter les attentats de Timothy McVeigh (qui fit 168 victimes) et de J.A Muhammad (l’appendice n’indique aucune victime, alors qu’il tua 10 personnes), on constate que le taux de létalité «remonte» à 1.51 victimes/attaque. Il est ainsi probable qu’en élargissant l’échantillon à des pays qui ont assisté à des attaques de loups solitaires ces dernières années, le taux pourrait correspondre à la moyenne de 1.62 victimes/attaque évoquée précédemment. L’inclusion (ou l’exclusion) des attentats d’Oklahoma City change de façon significative les conclusions quant à la létalité des actions.
Dans son ouvrage Understanding Terrorism in America, le sociologue Christopher Hewitt a montré que le terrorisme du loup solitaire est – même sans être exclusif – un phénomène plus largement répandu aux Etats-Unis qu’ailleurs. Les raisons de cette prédominance sont multiples: d’une part, le concept de résistance sans leader est populaire auprès de l’extrême-droite et des mouvements anti-avortement, particulièrement actifs dans des actions de loup solitaire. De plus, il s’agit également d’une conséquence de l’action efficace des services de police américains contre les mouvements extrémistes. La résistance sans leader et le terrorisme du loup solitaire constituent une façon de contourner la surveillance policière (p. 31).
Les observations d’Hewitt sont corroborées par Spaaij qui montre que, sur les 88 loups solitaires pris en considération, près de 40 ont agi aux Etats-Unis (p. 30), soit le 45 % des cas. Au niveau des attaques, 113 attaques (sur son échantillon de 198) ont été perpétrées dans ce même pays, soit près de 57 % (p. 30).
L’Italie vient au second rang, avec l’«Unabomber italien» (dont l’identité n’est pas connue), qui a commis près de 30 attentats sur la période 1994-2006. L’auteur montre également que, même s’il s’agit d’un phénomène essentiellement américain, l’augmentation la plus spectaculaire entre 1970 et 2000 n’a pas eu lieu aux Etats-Unis, mais en Europe (pp. 32-33).
4. Problèmes épistémologiques
Les motivations les plus fréquentes pour des actions du loup solitaire sont liées à l’extrême-droite et le «suprématisme blanc» (17 %), à l’islamisme (15 %) et à l’opposition à l’avortement (8 %) (p. 37-38). Spaaij soulève cependant une question épistémologique importante: dans le cas du terrorisme du loup solitaire, comment déterminer les motivations exactes des terroristes, alors que ceux-ci présentent souvent une «combinaison complexe de motifs politiques, idéologiques et personnels» (p. 40)? Est-il possible de leur appliquer une affiliation idéologique et politique unique?
L’auteur illustre cette difficulté en discutant la complexité des motivations de Kaczynski, Amir, David Copeland et Anders Behring Breivik. Dans ce dernier cas, Spaaij cite notamment les réflexions du chercheur norvégien Thomas Hegghammer pour qui la vision du monde de Breivik «n’entre pas totalement dans les catégories établies de l’extrême droite». Pour lui, l’idéologie de Breivik relève du «macro-nationalisme», une variante de nationalisme appliquée à des faisceaux d’Etats-nations liés entre eux par une notion d’identité partagée (p. 40, voir également l’article original d’Hegghammer).
Dans une analyse publiée sur Religioscope, le chercheur suisse Jean-François Mayer avait également remarqué la complexité des motifs invoqués par Breivik et la difficulté d’appliquer une «étiquette» claire à son action. Selon lui, «il n’est donc pas impossible de le qualifier de “terroriste chrétien”, puisque telle est bien une part de son identité revendiquée. Mais on peut tout aussi bien le définir comme “terroriste islamophobe”, “terroriste conservateur”, “terroriste antimuticulturaliste”, “terroriste antimarxiste” (il arborait sur un uniforme une inscription Marxist Hunter, “chasseur de marxiste”), “terroriste européen”… laquelle de ces étiquettes choisir? Nous restons indécis (…)».
Il s’agit probablement là d’un problème spécifique lié au terrorisme du loup solitaire: la difficulté à définir exactement les motivations des acteurs. De ce fait, on peut parler d’une prédominance de certains thèmes, même s’il est difficile d’en tirer des conclusions définitives.
Spaaij note également un problème important dans l’analyse du terrorisme du loup solitaire. Il note que «le temps et une enquête approfondie découvrent des liens avec des réseaux plus larges qui indiquent qu’une attaque terroriste peut ne pas avoir été une occurrence de terrorisme du loup solitaire» (p. 11).
Ceci constitue un problème majeur dans l’analyse du phénomène et l’analyse de Spaaij n’y fait pas exception. En effet, celui-ci considère dans son analyse le cas de Taimour Abdulwahab al-Abdaly, qui s’est fait exploser en décembre 2010 à Stockholm. Même s’il admet qu’al-Abdaly aurait pu bénéficier d’une assistance (p. 116), il ne l’exclut pas de son échantillon.
5. La santé mentale des loups solitaires
Au niveau des motivations personnelles, Spaaij soulève un autre point important. Ainsi, la recherche sur les groupes terroristes laisse penser qu’il n’existe pas de type d’identité psychologique particulière des terroristes. Pour reprendre Francisco Reinares, un chercheur espagnol, «les personnes qui s’engagent dans des activités terroristes ne sont mentalement pas perturbées et n’ont rien de remarquable en termes psychologiques» (p. 49). Pourtant, dans le cas du terrorisme du loup solitaire, Spaaij note que, en comparaison avec le terrorisme de groupe (group-actor terrorism), «les loups solitaires ont tendance à présenter une plus grande propension à souffrir de problèmes liés à la santé mentale» (p. 50).
Ainsi, quatre des cas paradigmatiques (Amir, Kaczynski, Copeland, van der Graaf) présentés ont été diagnostiqués de troubles de la personnalité ou sont passés par des épisodes dépressifs. De plus, l’auteur note également que les loups solitaires «ont tendance à présenter un degré (variable) d’inefficacité et d’aliénation sociale (p.51)».
Spaaij partage ici les conclusions du chercheur Raffaelo Pantucci, auteur d’une étude sur les terroristes du loup solitaire islamistes. Selon Pantucci, «des problèmes mentaux ou une incapacité sociale générale sont sous-jacents aux histoires de plusieurs des individus mentionnés dans cet article» (p. 35).

Anders Breivik
Anders Behring Breivik semble également entrer dans ce schéma d’analyse. Selon une expertise psychiatrique, celui-ci souffrirait de «schizophrénie paranoïde». Une contre-expertise a récemment été exigée.
Les observations de Spaaij quant à la santé mentale des loups solitaires soulèvent de nombreuses questions. En effet, considérer le terrorisme du loup solitaire comme la manifestation collective de pathologies individuelles ne reviendrait-il pas à simplifier le problème et à réduire la complexité des motivations (idéologiques, politiques) des terroristes à une «simple» pathologie mentale?
Ceci ne reviendrait-il pas à ignorer les ravages de certains courants idéologiques dans lesquels s’inscrivent certains actes terroristes, voire tout simplement à les excuser? Et en les excusant, ne risque-t-on pas des récidives d’acteurs proches (ou affiliés)?
Dans le cas plus spécifique d’Anders Behring Breivik, on peut considérer les conclusions de l’expertise psychiatrique comme une punition pour son auteur, qui semble considérer son pamphlet comme un travail idéologique important. Il a d’ailleurs immédiatement contesté les résultats de l’expertise. Ainsi l’un de ses avocats affirme que Breivik «est préoccupé par le fait que ces experts n’ont pas assez de connaissance des idéologies politiques. Il pense qu’ils ont qualifié de bizarres certaines de ses déclarations qu’il estime ne pas être bizarres. Et il ne partage pas leur jugement selon lequel il est un malade mental».
Pourtant, qu’en est-il d’autres loups solitaires moins narcissiques? La «déclaration de folie» pourrait-elle également être considérée comme une punition dans ces cas?
Conclusion
L’analyse proposée par Ramon Spaaij offre des informations pertinentes et actuelles sur un phénomène méconnu, le terrorisme du loup solitaire. Malgré les problèmes définitionnels et épistémologiques évoqués, il s’agit d’une des analyses les plus systématiques du phénomène proposée actuellement.
On regrettera que, alors qu’il évoque l’analyse de Raffaello Pantucci, son échantillon n’évoque que de manière limitée les loups solitaires islamistes (pour autant que ceux-ci aient agi dans l’un des 15 pays considérés). De plus, même s’il évoque très concrètement le cas de Yigal Amir, quelques réflexions plus approfondies sur le terrorisme du loup solitaire en Israël auraient permis une analyse plus large des motivations religieuses de ces individus.
Bibliographie
– Hewitt, Christopher, Understanding Terrorism in America, Routledge, 2002.
– Pedahzur, Ami et Perlinger, Arie, Jewish Terrorism in Israel, Columbia University Press, 2009.
– Pantucci Raffaelo, «A Typology of Lone Wolves: Preliminary Analysis of Lone Islamist Terrorists», International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2011, disponible en PDF en cliquant sur ce lien.
– Sprinzak, Ehud, Brother Against Brother: Violence and Extremism in Israeli Politics, Simon & Schuster, 1999.
