Dans l’antiquité romaine, les portes du temple de Janus – “le Dieu des entreprises propices” – avaient une fonction bien définie. Ouvertes, celles-ci signifiaient que Rome était en guerre, alors que fermées, Rome jouissait de la paix. Les positions philosophiques de Michael Walzer sur le terrorisme et la guerre, réunies dans un ouvrage paru récemment, De la Guerre et du Terrorisme (Bayard, Paris, 2004) ressemblent à ce temple: même si son gardien aimerait les garder fermées, certaines positions pourraient contribuer à justifier le terrorisme.
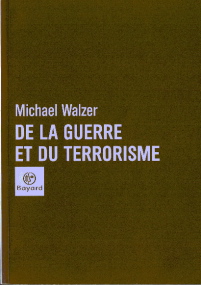 Michael Walzer, professeur en sciences sociales à l’institut des hautes études de l’université de Princeton, est probablement l’une des figures incontournables du paysage intellectuel contemporain. Dans son ouvrage paru en 1977, Just and Unjust Wars (traduction française Guerres justes et injustes, Paris, Belin, 1999), Walzer disqualifie a priori le terrorisme de la sphère des actions justes. Il n’a cessé depuis de défendre cette position et de fustiger les apologues de la terreur.
Michael Walzer, professeur en sciences sociales à l’institut des hautes études de l’université de Princeton, est probablement l’une des figures incontournables du paysage intellectuel contemporain. Dans son ouvrage paru en 1977, Just and Unjust Wars (traduction française Guerres justes et injustes, Paris, Belin, 1999), Walzer disqualifie a priori le terrorisme de la sphère des actions justes. Il n’a cessé depuis de défendre cette position et de fustiger les apologues de la terreur.
Cet ouvrage constitue un recueil de ses textes les plus importants parus après 1977 sur le thème de la guerre juste et du terrorisme. On trouve ainsi des articles dédiés aux urgences suprêmes (“une morale de l’urgence”, 1988) et au terrorisme et ses justificateurs (“critique de “l’excuse”: le terrorisme et ses justificateurs”, 1988). Du point de vue des relations internationales, Walzer traite, entre autres, de la première Intifada (“L’Intifada et la ligne verte”, 1988), du conflit israélo-palestinien (“les quatre guerres israélo-palestiniennes”, 2002) et du 11 septembre (“L’après-11septembre: cinq interrogations”, 2002).
L’ouvrage s’achève sur une réflexion sur la guerre en Irak (“Cinq commentaires sur la situation en Irak”, 2002-2003 et “Des mauvais traitements infligés aux soldats irakiens”, inédit).
Les portes du temple fermées: Walzer le polémiste
Dans son essai “critique de “l’excuse”: le terrorisme et ses justificateurs” (pp. 80-98), Walzer affirme que “nous connaissons une culture politique de l’excuse” (p.82) et propose une critique de ces excuses apportées au terrorisme. Il répète certaines de ces critiques dans son article dédié au 11 septembre, “L’après-11septembre: cinq interrogations” (pp. 171-185).
Même s’il refuse de mentionner explicitement des “apologues” du terrorisme, il cite au passage le défunt intellectuel palestinien Edward Saïd et l’ancien éditeur du magazine de gauche américain The Nation, Richard Falk.
La première excuse apportée au terrorisme est le fait qu’il constitue une solution de “dernier recours”, alors que toutes les autres possibilités ont déjà été épuisées. Walzer oppose à cette excuse le fait que souvent, les militants recourent en premier au terrorisme, sans avoir essayé aucune autre possibilité: “le FLN et l’OLP ont opté pour la terreur dès les premiers jours, sans se mettre en peine d’alternatives” (p. 177).
Une autre “excuse” souvent invoquée est le fait que le terrorisme est la conséquence de “la misère humaine, [de] l’épouvantable pauvreté, [des] vastes inégalités globales” (p. 173). Pour Walzer pourtant
“La misère et l’inégalité ne suffisent pas à expliquer l’apparition des mouvements nationalistes terroristes, notamment islamiques. On le voit bien en se livrant à un exercice de comparaison politique. C’est en Afrique, indubitablement, qu’apparaissent les pires retombées de l’inégalité globale; la responsabilité des Occidentaux quant à la production et la reproduction de l’inégalité y est flagrante et demeure majeure (…). Et pourtant la diaspora africaine n’est pas une serre chaude où éclosent les terroristes.” (p. 173-174).
Malgré le caractère très polémique de ces deux essais, qui pourrait laisser croire à une apologie de certains gouvernements et de leur politique, les positions de Walzer sont plus différenciées. Ainsi, alors qu’il fustige le terrorisme, celui-ci vante la première Intifada:
“ce que les terroristes de l’OLP ont échoué à obtenir après vingt ans de combat, des adolescents armées d’une fronde l’ont suscité en l’espace de huit mois. Ils ont fait place à la Palestine sur une cartographie morale, aux côtés d’Israël.” (p. 143)
Ouvrir les portes: urgences suprêmes et terrorisme
Malgré sa condamnation sans équivoque du terrorisme qui “consiste à tuer délibérément des innocents pris au hasard afin de semer la crainte dans une population et de forcer la main à ses dirigeants politiques” (p. 171-172), Walzer justifie le fait que, dans certaines situation de guerre, les hommes politiques peuvent ordonner des violations massives du principe de discrimination des civils/ non-combattants. Dans ces situations que Walzer appelle “urgences suprêmes” (on doit ce terme à Winston Churchill qui qualifia ainsi la survie de l’Angleterre au début de la seconde guerre mondiale), les règles morales qui régissent normalement les conflits doivent être “outrepassées” (p. 58): le bombardement des villes allemandes par les Anglais avant 1942 constitue justement un cas d’urgence suprême. D’un point de vue moral, cette décision, même si elle immorale, est pour Walzer moralement défendable. Cette pratique immorale se restreint cependant aux hommes politiques et non aux soldats à titre individuel.
On comprendra mieux cette distinction si l’on considère l’importance accordée au concept de communauté par Walzer. Par communauté, il entend “[la communauté] ne représente pas seulement les individus, mais l’entité collective – religieuse, politique ou culturelle – qu’ils composent dans leur ensemble, et qui leur inspire certains traits de caractère, certaines pratiques et certaines croyances” (p. 69). Il faut distinguer ici la communauté de l’État-nation: pour Walzer, l’Etat-nation est important dans la mesure où il sert les objectifs communs de la communauté (p. 69, n. 11), mais il lui reste subordonné. Une communauté politique n’est cependant pas exclusivement un phénomène limité au présent: elle entretient des relations avec le passé et le futur. Ainsi une communauté politique est le résultat de certaines pratiques ancestrales qui forment les pratiques actuelles qui seront à leur tour léguées aux générations à venir, “cet effort de continuité, renouvelé de génération en génération, représente un aspect capital de l’existence humaine et c’est la communauté qui l’incarne” (p. 70). C’est l’importance de la communauté qui permet la transgression du principe de non-discrimination
“Lorsque la nôtre [Walzer parle ici de la communauté] est menacée, non seulement dans son extension territoriale présente ou dans la structure, le prestige, voire l’honneur de ses institutions, mais dans sa “persistance” même, nous affrontons une perte supérieure à tout ce que nous pouvons imaginer, hormis la fin de l’humanité elle-même. Une extinction morale autant que physique, la fin d’un mode de vie autant qu’une somme de vies particulières, la disparition des ‘gens comme nous’.” (p. 70)
En acceptant cette argumentation, pourrait-on alors justifier le terrorisme, transgression du principe de discrimination des non-combattants? Walzer revient sur ce point dans sa “critique de “l’excuse”: le terrorisme et ses justificateurs”. Pour lui, le terrorisme ne pourrait se justifier comme “urgence suprême” que dans le cas d’un génocide
“Le terrorisme serait-il justifié en cas’d’urgence suprême’ (…)? Peut-être mais seulement si l’oppression combattue constituait un génocide (…). Mais ce genre de menace n’a jamais joué dans les cas récents d’activités terroristes.” (p. 84).
Walzer part du principe qu’il est possible de déterminer de manière strictement objective les conditions de l’imminence d’un génocide. Est-ce véritablement le cas? La perception des individus et tout particulièrement des leaders politiques pour déterminer un génocide n’est-elle pas essentielle?
Dans son article “Terrorisme et religion: continuité et mutation de la violence politique”, l’historien et spécialiste des religions Jean-François Mayer note que, souvent, les terroristes religieux vivent dans l’expectative d’une catastrophe imminente
“En fait, tous les groupes dits ‘fondamentalistes’ découlent de la perception d’une menace, d’une angoisse face à des adversaires très puissants. Quand se développe le sentiment d’une menace pour l’existence, des comportements extrêmes paraissent soudain justifiables.” (“Terrorisme et religion: continuité et mutation de la violence politique”, dans Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, p. 51).
Dans quelle mesure le sentiment des leaders fondamentalistes face aux menaces qui pèsent sur eux et leur communauté est-il différent du sentiment des Britanniques face à la menace nazie? On pourrait invoquer ici le caractère unique de cette dernière. Pourtant, cette réponse n’est-elle pas largement déterminée post-factum, c’est-à-dire à une époque où le nazisme est un phénomène bien connu et bien étudié? Dans ce cas, le terrorisme religieux ne serait-il pas alors justifiablepar l’argument des urgences suprêmes?
Conclusion
Malgré tous ces efforts pour vilipender le terrorisme et garder ainsi la porte du temple fermée, on trouve des tendances divergentes au sein du système walzérien. D’une part, les efforts polémiques de condamnation des apologues du terrorisme et du terrorisme lui-même. D’autre part pourtant, l’argument des “urgences suprêmes” qui, poussé dans ses extrémités, pourrait conduire à défendre une thèse contraire: la justification du terrorisme.
On conseillera pour terminer aux lecteurs intéressés par les relations complexes entre la gauche américaine et la guerre juste, la lecture du premier article du recueil (“le – dangereux – triomphe de la guerre juste?”, pp. 19-44) qui éclaire cette question compliquée.
Jean-Marc Flükiger
Michael Walzer, De la guerre et du terrorisme, Paris, Bayard, 2004.
